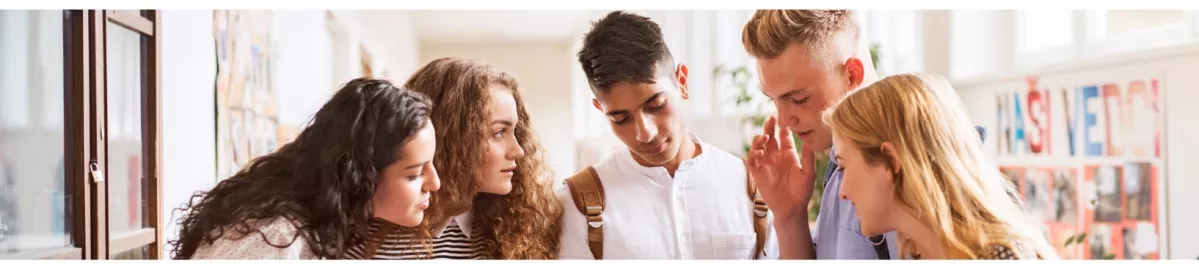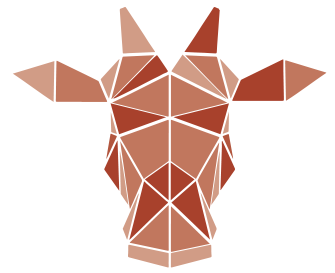Le masking : un camouflage qui protège… jusqu’à l’épuisement
Le premier épisode révèle un phénomène aussi courant que méconnu : le masking, ou camouflage social. Beaucoup d’étudiants TSA, TDAH, DYS ou HPI s’y engagent sans même en avoir conscience. L’objectif est simple : imiter, s’ajuster, se fondre dans l’environnement pour éviter le jugement ou le décalage visible.
Ce mécanisme commence souvent tôt, dès que l’école renvoie l’idée qu’il serait préférable d’être « comme les autres ». Protecteur au départ, il devient avec le temps un costume trop serré qui épuise, éteint l’élan, et brouille la compréhension de ses propres besoins réels.
Les signes sont nombreux :
– fatigue persistante, sans explication apparente
– changement de rôle selon les contextes
– hypercontrôle du comportement ou des émotions
– difficulté à savoir ce que l’on ressent vraiment
– sensation de décalage interne, comme si deux versions de soi coexistaient
Dans leur échange, Catherine Cornil et Richard Lablée proposent deux appuis simples pour avancer :
- Nommer ce qui se passe pour desserrer la pression.
- Retrouver des repères internes pour réapprendre à se faire confiance.
Ils s’appuient pour cela sur des travaux majeurs — de Laura Hull, Francesca Happé, Meng-Chuan Lai, Russell Barkley ou Uta Frith — qui montrent combien le masking, s’il n’est pas identifié, peut peser sur la motivation, l’apprentissage et le sentiment d’authenticité.
Écouter sur PSH SUP RADIO :
Le moteur de F1 : quand l’intensité devient un besoin vital
À l’opposé apparent — mais en réalité en miroir — le second épisode explore un fonctionnement presque inverse : celui des personnes qui ont besoin non pas de calme, mais d’intensité pour se sentir bien.
Certains cerveaux neuroatypiques s’allument uniquement lorsque le sens est clair, que la stimulation est présente, que l’élan intérieur peut se déployer. Le calme absolu, loin d’apaiser, peut devenir anxiogène, car il coupe la dynamique qui fait avancer.
L’analogie du moteur de F1 illustre parfaitement ce phénomène :
- un moteur puissant a besoin d’être réglé, pas bridé
- trop de contraintes éteignent la motivation
- la bonne dose de stimulation met en route l’engagement
- les pauses ne freinent pas le fonctionnement : elles permettent la maturation des idées
Les recherches de John Hattie, Barbara Oakley ou Russell Barkley éclairent cette mécanique : ce n’est pas la quantité d’efforts qui compte, mais le sens, l’intérêt, le défi. Lorsque ces éléments sont absents, même les étudiants les plus brillants peuvent décrocher, non par manque de capacité… mais par manque d’allumage.
Écouter en entier :
Un lien commun : restaurer la confiance dans ses propres réglages internes
Derrière ces deux podcasts, une même idée se dessine :
La neurodiversité n’est pas un problème à corriger, mais un fonctionnement à comprendre.
Le masking montre les risques de s’effacer pour s’adapter.
Le moteur de F1 montre les risques de s’éteindre quand le sens manque.
Dans les deux cas, la clé consiste à :
- reconnaître son rythme
- identifier ses appuis internes
- oser être en cohérence avec son fonctionnement
- trouver un environnement qui soutient plutôt qu’il contraint
Ces épisodes donnent ainsi des repères précieux pour mieux accompagner les étudiants, mais aussi pour mieux se comprendre soi-même : savoir quand on s’adapte trop… et savoir quand on a besoin de plus d’intensité pour avancer.